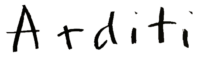Depuis près de soixante ans qu’il le parcourt, l’itinéraire pictural de Georges Arditi, pour sinueux qu’il puisse paraître et en raison même de ses méandres, n’en est pas moins l’un des plus significatifs de l’art de ce siècle et de ses problématiques majeures.
A l’écart, en effet, de toutes les « avant-gardes », concept qu’il récuse d’ailleurs vigoureusement en tant qu’impliquant une ridicule idée de progrès dans le développement historique de l’art, loin donc de ces excès et de ces « gadgéteurs », comme il appelle lui-même les éphémères et excentriques vedettes de notre scène artistique, Arditi n’a cessé de chercher le centre de gravité de la peinture et donc de poser la cruciale question de son rapport au réel.
Il divise lui-même son cheminement en périodes distinctes, et clairement repérables, quatre exactement, dont nous reparlerons plus loin, mais il faut dire toute de suite qu’elles sont quatre compartiments d’un même monde parcouru, ou mieux comme les quartiers d’un même cercle dont seul importait le centre. Centre dont cette fin d’une préface de Paul Valéry, consacrée à l’exposition « L’art italien de Cimabue à Tiepolo » qui eut lieu à Paris en 1935, nous fournira la meilleure des idées : « L’Italie avait compris que ni l’imitation du réel, ni l’affirmation d’une sensibilité ne contentent tout l’être, et que ces deux conditions de l’art plastique, qui sont indépendantes l’une de l’autre, puisqu’on peut y satisfaire séparément, ne s’unissent dans une œuvre que moyennant toute cette subtilité et toute cette rigueur savante qui en ordonnent le travail selon la hiérarchie même de l’esprit. Dante n’avait pas conçu autrement l’art du poète ».
Rien ne me semble pouvoir mieux que ce texte résumer le parcours de Georges Arditi, ni désigner ce vers quoi il tend. Certes son œuvre compte quatre moments ou faces, mais elle a deux pôles, la figuration : « l’imitation du réel », et l’abstraction : « l’affirmation d’une sensibilité », préoccupations auxquelles il a effectivement pu satisfaire séparément, et elle n’a qu’une quête, celle de cette « rigueur savante » qui ordonne le visible selon les lois de l’esprit. Car comme le disait Jean Hélion, dont il n’est pas insignifiant qu’il ait luï aussi effectué un semblable et remarquable aller et retour figuration-abstraction-figuration : « Pour celui qui regarde d’abord au dehors, réaliser une peinture, c’est transformer ce qu’il voit en quelque chose qui puisse être peint ». Les peintres les plus peintres sont peut-être ceux qui ont le mieux cerné ce troisième terme entre le visible et le tableau et qui n’est autre que leur vision de peintre, cette opération de l’esprit qui va rendre tel paysage ou figure traduisible dans la langue du pinceau. C’est cela, cela seulement, n’en déplaise aux conceptuels se réclamant de lui, que voulait dire Vinci déclarant la peinture « cosa mentale ».
La peinture ne ressemble pas au monde, ce qui serait sans intérêt, mais au regard posé sur le monde par un peintre, ce qui n’a rien à voir, mais ce qui en fait un art c’est-à-dire une orchestration, renouvelée de peintre en peintre, d’un visible qui ne l’est pour nous que par leurs œuvres.
C’est seulement, semble-t-il, à partir de ce préalable, ou de ce noyau, que l’oeuvre d’Arditi peut être perçue pour ce qu’elle est ; bien loin d’une errance dispersée et tâtonnante, la recherche des plus essentielles articulations du réel et du peint.
On peint pour montrer le monde. Puis on montre le monde pour montrer la peinture. Et puis on montre la peinture pour montrer le monde, et comme elle l’exalte. Ceci rappelle l’un des plus célèbres et pénétrants des aphorismes du Zen: « Avant que j’eus pratiqué le zen, les montagnes n’étaient que des montagnes et les nuages, que des nuages. Quand j’eus commencé la pratique du zen, les montagnes ne furent plus des montagnes, les nuages n’étaient plus des nuages. Maintenant que j’ai vraiment pratiqué le zen, les montagnes sont enfin des montagnes, les nuages sont enfin des nuages ». Que l’on remplace ici à chaque fois le mot zen par le mot peinture, et l’on aura compris à peu près tout à cet art en général et à la démarche d’Arditi en particulier.
De 1938 à 1946, c’est la première phase, qu’il nomme classique et quattrocentiste, de son œuvre. Des scènes familiales, essentiellement, étrangement figées entre une lumière douce et un modelé qui ne l’est nullement. Des instants devenus formes, de la mémoire devenue matière, presque palpable. C’est que, comme pour tout méditerranéen habitué à une lumière qui flatte le saillant des volumes, peindre c’est sculpter et Arditi reprendrait bien à ce moment au compte de la peinture la définition fameuse que le Corbusier donne à l’architecture: « le jeu correct et magnifique des volumes dans la lumière ». C’est aussi sa période que je dirais la plus romantique, tant s’y glisse de nostalgie et du sentiment de l’urgence qu’il y a à sauver ces moments qui, devenus peintures, seront au moins devenus mémoire. Peut-être est-ce cela qui les nimbe de mystère et les apparente à celles d’un Balthus qu’il ne connaît pas encore, mais l’ambiguïté en moins.
Puis, jusque vers 1958 à peu près, l’essentiel de son travail va consister en une croissante simplification du visible. Cette seconde période, qu’il qualifie de post- cubiste, semble celle où il va ordonner son regard, le soumettre à un langage toujours plus épris de radicale évidence. Les détails sont bannis, et le modelé lui-même est devenu un détail. Les objets, telle machine à coudre par exemple, tendent à s’identifier à des rythmes de lignes, des battements colorés. Le monde entier, jusqu’à la figure humaine elle-même, semble n’aspirer plus qu’à devenir musique picturale, un Bach de couleurs, fantaisie chromatique et fugue de surfaces.
A partir de 1959 et jusqu’au début des années soixante-dix, cette aspiration va se réaliser de plus en plus complètement, jusqu’à dépasser même finalement (la suite le montrera) les espérances du peintre, avec la troisième période, dite abstraite. L’est-elle d’ailleurs vraiment ? Si cet éclatement de couleurs, ce foisonnement de lignes ne désignent certes plus tel ou tel objet en particulier, leur référence et partenaire n’en demeure pas moins, comme avant et comme après, le monde, le réel, le visible. Voici une abstraction encore bouillonnante de soleil, et gorgée des sucs de toutes les fleurs.
Kandinsky, on le sait, à la question « par quoi remplacer le sujet ? », lorsque s’ouvrait devant lui et selon ses propres mots « l’abîme de la peinture abstraite », répond : « par la nécessité intérieure ». Arditi, alors même qu’il est en apparence le moins figuratif, garde encore la réalité extérieure comme seul vrai partenaire, répondant et guide. Certes l’abstraction convient mieux à la pure « affirmation d’une sensibilité », pour reprendre les mots de Valery, mais d’une sensibilité à quoi ? Et si elle est à la beauté du monde pourquoi ne pas le dire, le reconnaître, le manifester et le claironner carrément.
C’est ce vers quoi va incliner Arditi en son actuelle période, commencée il y a une quinzaine d’années, affirmer sa fidélité au monde. Et ce d’autant plus que ce monde, le nôtre, et sa beauté, lui apparaissent comme chaque jour davantage menacés par nos bêtises et nos aveuglements. A son souci de peintre de manifester le visible vient s’ajouter une préoccupation d’homme d’en témoigner et d’en sauver même ce qui peut l’être.
A nouveau, pour lui comme pour le poète zen, les montagnes sont redevenues des montagnes et les nuages des nuages. Mais, pour nous, combien de temps ces splendeurs le demeureront-elles ?
Ainsi Arditi constitue-t-il son œuvre en petit théâtre de mémoire, en scénographies de la beauté du monde. Il retrouve par là même l’essentielle vocation que ses chers primitifs italiens avaient assigné à la peinture : conférer à nos regards assez de talent et d’amour pour les rendre dignes de se poser sur la merveille perdue et, dès lors, retrouvée du monde.
Gérard Barrière le 11 Août 1990